|
 
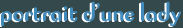
Rencontre avec la chorégraphe
Max-Laure Bourjolly de la compagnie
Boogi Saï.
Pour
en revenir au parcours de Boogi Saï,
avez-vous eu des difficultés
particulières face aux administrations
ou aux institutions, par exemple?
Bien
sûr, on a rencontré des
difficultés parce que, quelque
part, nous, danseurs et chorégraphes,
sommes toujours dans un rêve.
Lorsqu'on a monté une création
et que le public nous a ovationné,
on part, on est dans un rêve,
on est heureux. Et après, il
y a l'autre paramètre, il y
a tout le côté administratif
à gérer, et c'est ce
côté qui fait que, finalement,
on finit par redescendre sur terre,
et se dire qu'il y a tout un travail
à faire derrière, tout
un travail de relance par rapport
à la création, un travail
de communication. Et ce travail-là,
est aussi présent que le travail
artistique, on ne peut pas passer
à côté, et là
on redescend sur terre, vraiment.
Et puis, il y a des choses qu'on ne
maîtrise pas, qui sont politiques,
après c'est tout un jeu tactique.
Alex
Benth, votre collaborateur et co-fondateur
de Boogi Saï, exprimait "le
mépris du monde culturel"
à l'égard de la danse
hip hop, ressentez-vous la même
chose ?
Oui,
disons qu'il y a une période
où c'était clair, on
le voyait, on le ressentait, à
la rigueur, ça nous donnait
même matière à
exprimer notre rage. Et puis il y
a une autre période, où
le discours disait qu'on nous reconnaissait,
qu'on reconnaissait la danse hip hop,
le danseur hip hop, l'écriture,
l'école. Et à côté
de ça, pour pouvoir la reconnaître,
il fallait qu'on se mélange,
qu'il y ait de la mixité entre
danse hip hop et danse contemporaine.
Donc, là, c'est vrai qu'à
un moment donné c'était
complexe dans nos esprits, parce qu'on
avait envie d'affirmer nos différences,
pas forcément la mixité
d'ailleurs, peut-être à
travers ce que nous sommes nous :
des danseurs hip hop. Mais ce qui
me dérangeait, c'était
comme si on nous obligeait à
adopter une autre identité
pour pouvoir exister, et là
c'était injuste. Donc, c'était
cette période-là, à
travers les reportages à la
télé, d'ailleurs sur
Arte, on a bien pu le voir, des contemporains
qui s'exprimaient d'une manière
qui m'a choqué un petit peu,
et je ressentais un cela comme une
mainmise sur le hip hop, et ça
n'est pas vieux.
Et y a-t-il
évolution ?
Je
pense que l'évolution est de
notre côté, on a compris
ça et on détourne (geste
de la main qui prend un virage à
gauche, en contournant, une masse
"invisible"). C'est-à-dire
que, petit à petit, on a mesuré
les paramètres et on s'est
dit "Bon, il faut qu'on maîtrise
de plus en plus notre historique",
et qu'on puisse en face pouvoir avoir
des éléments pour être
objectifs aussi, et pour pouvoir dire
"Nous sommes ça".
S'il faut qu'on collabore, il faut
accepter cette différence-là
aussi. Nous sommes prêts à
collaborer, mais il faut qu'on ressente
les deux pôles, et pas uniquement
leur vision des choses. Je pense que
nous avons évolué là-dessus.
C'est Boogi Saï et les leaders
des autres compagnies -de ma génération-
qui ont mûri, qui ont compris
des choses, là je parle d'une
philosophie plus généralisée.
Il y a des choses qu'on a compris
-tous- parce qu'à travers Boogi
Saï, nous avons compris des choses,
mais à nous seuls, on ne peut
pas changer le monde. Mais à
plusieurs on a compris des choses
et ça se ressent.
C'est
votre seconde participation au festival,
avez-vous conçu ce spectacle
pour les rencontres de la Villette
?
Disons
qu'à la base, nous étions
en résidence au Forum Culturel
du Blanc-Mesnil. Nous avons été
soutenus par ce théâtre-là,
qui est un théâtre conventionné,
et par la suite, on a embrayé
sur la Villette, qui nous suit et
nous soutient. Il y a également
la DRAC d'Ile-de-France qui nous aide.
Est-ce
difficile de faire un spectacle de
trente minutes ?
Au
début, j'étais partie
sur une heure. Mais avec le temps
que le Blanc-Mesnil nous a donné,
on a deux mois de création
dans les lieux. Au bout de deux mois,
avec un troisième élément
qui est la vidéo, je ne pouvais
pas aller au-delà d'une demi-heure,
parce que la vidéo est une
création. La danse, la lumière
et la musique aussi. Donc, ça
faisait beaucoup en peu de temps.
J'ai décidé de développer
un tableau, le monde virtuel, parce
que dans mon histoire, il y a un monde
virtuel et un monde réel.
Pour quelles
raisons avez-vous justement exploré
la virtualité pour ce spectacle
?
C'était
mon truc, parce que quelque part,
je n'arrive pas à parler de
choses que je ne ressens pas ou que
je ne vis pas. Il faut que je les
vive pour pouvoir en parler, sinon
je n'arrive pas à créer
une histoire. Il faut vraiment que
je sente ce que je vais retranscrire
sur scène. C'est-à-dire
que, par rapport à la virtualité,
je pense qu'on est dans une époque
où, non seulement on subit
le virtuel, mais on utilise le virtuel.
A l'image de ce que l'on voit à
la télé, tout est schématisé
par le virtuel. Quand on commence
à voir un spot publicitaire,
(gestes) hop hop, ça
s'amène, et ça n'est
pas une image réelle, c'est
une image virtuelle. Même pour
les génériques, c'est
encore des images virtuelles, on est
baignés dedans, on y est habitués
ça devient naturel, alors que
c'est du virtuel. Et puis, j'adore
jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui,
autour de nous, tout le monde utilise
des ordinateurs, donc on est baignés
dans cet univers. Je suis dans un
contexte que je vis, que je ressens
et puis il y a d'autres thèmes
traités à l'intérieur,
notamment la solitude, l'anonymat,
l'exclusion, et le besoin de communiquer.
C'est vrai à l'image de ce
que je vis aussi au quotidien, par
exemple quand je prends le métro,
j'ai l'impression que les gens ne
se regardent plus, ne communiquent
plus, comme si nous étions
des numéros. On se bouscule,
on ne se dit même plus pardon,
on ne se dit plus bonjour. On ressent
un manque de communication, l'anonymat,
l'enfermement, les gens sont de plus
en plus seuls. Et c'est vrai qu'à
travers la pièce, j'ai eu envie
de développer l'histoire d'un
personnage qui ne trouve pas sa place
dans un monde réel, et qui
a eu envie de rentrer dans un monde
virtuel, de se créer son monde
à lui. C'est ce qu'on peut
retrouver à l'image des personnes
qui essaient de communiquer par emails
ou par d'autres formes qui existent
sur Internet. Finalement les gens
ne se voient pas, c'est une communication
virtuelle. Et quelque part, ils éprouvent
toujours la peur de se rencontrer,
parce que, pour exagérer un
peu, celui qui est un peu déformé,
qui a une bosse là (elle
se penche, voûte son dos, et
de la main dessine une bosse derrière
l'épaule), se dit, "J'ai
un bon pote sur le net, mais je n'aimerais
pas qu'il me voit, il ne va peut-être
pas me kiffer si jamais il me voit
en vrai". Donc, il y a toujours
ce côté, où ça
reste quand même de la communication
virtuelle, où les gens sont
seuls. Et j'ai eu envie d'en parler.
Mais, quelque part, mon histoire se
termine "bien" entre parenthèses,
parce que face à leur monde,
ils finissent par se libérer,
par être à visage découvert
et se dire qu'ils sont libérés
d'un enfermement. Ce personnage finit
par se retrouver avec d'autres gens
comme lui. Pendant, le spectacle,
on ressent ce besoin de communiquer,
cet enfermement, et puis tout d'un
coup, hop, à visage découvert,
et non, finalement on est seul, et
à la fin ils se retrouvent.
|